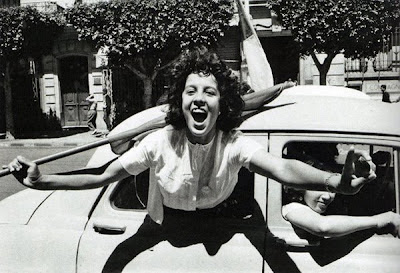"Paix impossible, guerre improbable" est le titre du premier chapitre de l'ouvrage de Raymond Aron, Le grand schisme, publié en 1948. La formule, utilisée alors pour désigner la Guerre froide naissante, est régulièrement employée pour qualifier l'apogée de la Guerre froide (1947-1962). La question se pose de savoir si elle vaut, aussi, pour qualifier l'ensemble de la période 1945-1991.
Ce sujet, proposé dans le cadre du concours d'entrée à Sciences Po, peut être traité selon le plan suivant :
I. Une logique de Guerre froide : l'absence d'affrontements directs
II. La paix et la guerre sont cependant bien présentes
III. Une situation de paix armée
I. Une logique de Guerre froide : l'absence d'affrontements directs
L'enjeu de cette partie est de montrer que la logique de Guerre froide - soit l'existence de deux superpuissances en situation de pouvoir détruire l'autre, et tendant à l'hégémonie - impose l'absence de conflit direct.
1. Une paix impossible
- parce que Etats Unis comme URSS sont intimement convaincus du caractère agressif de l'autre.
| Affiche du comité "Paix et liberté" |
| Affiche anti-américaine. l'URSS, "citadelle assiégée". |
- parce que les modèles américain et soviétique sont diamétralement opposés, voire excluants l'un de l'autre. D'un côté, la démocratie libérale et le capitalisme; de l'autre, la démocratie populaire et l'économie socialiste. Ces deux modèles prétendent tous deux incarner l'idéal démocratique, garantir la liberté ( les libertés côté occidental, La liberté côté soviétique), être au service de la paix.
| La colombe de la Paix, Picasso |
- parce que Etats-Unis comme URSS se posent comme des modèles universels, ce qui suppose la dénonciation de l'autre. Les étapes de cette fracture sont connues : mars 1947, doctrine Truman/ juin 1947, plan Marshall / septembre 1947, création du Kominform.
Pour Truman :
" Chaque nation se trouve désormais en face d’un choix à faire entre deux modes de vie opposés.L’un d’eux repose sur la volonté de la majorité et il est caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, par l’absence de toute oppression politique. L’autre repose sur la volonté d’une minorité imposée par la force à la majorité. Il s’appuie sur la terreur et l’oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés individuelles".
(Discours au Congrès et à la nation, 11 mars 1947)
 |
| Doctrine Truman, schéma |
" Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale, à savoir la disposition en deux camps : le camp anti-impérialiste et le camp impérialiste.
Les États-Unis sont la force dirigeante du camp impérialiste. Ils sont soutenus par l’Angleterre, la France, par tous les États possesseurs de colonies tels que la Belgique et les Pays-Bas […]. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l’autre camp : l’URSS et les pays de la démocratie nouvelle tels que la Roumanie et la Hongrie en sont les fondements "
Jdanov, Rapport, 22 septembre 1947
2. ... la guerre improbable
- du fait de la dyssimétrie originelle entre les deux Grands, l'un, les EU, possédant la bombe A dès 1945, l'autre non. Ce qui explique le fait que les EU cherchent à tout prix à préserver le secret autour du nucléaire.
- Cette dyssimétrie fait rapidement place à un équilibre de la terreur : l'URSS se dote de la bombe A dès 1949, et de la bombe H, un an après les EU, en 1953. Cette courte période (1945-1953) voit la tension monter aux EU : peur du communisme et donc chasse aux communistes (maccarthysme), accusations d'espionnage dont certaines débouchent sur des procès retentissants comme celui des époux Rosenberg, condamnés à mort et exécutés en 1953, malgré la protestation internationale, comme au sein des Etats-Unis.
- La guerre est aussi improbable parce que l'arme atomique est dissuasive. Elle fait peser en permanence la menace de "représailles massives" ( doctrine Dulles). L'arme atomique n'est pas utilisée au cours des différents conflits qui marquent les années 1950, mais la menace est latente, toujours évoquée, comme en Corée (1950-1953), où le général Rigdway envisage son utilisation pour mettre un terme au conflit. En 1962, l'installation de rampes de lancement soviétiques sur territoire cubain entraîne une crise qui mène le monde "au bord du gouffre". Désormais, c'est la doctrine de la riposte graduée ( McNamara) qui prévaudra : il ne s'agit plus de promettre à l'autre une fin du monde, seulement une riposte à la mesure de l'agression qu'il oserait tenter.
- Enfin, le dernier facteur qui joue dans le sens d'une absence de conflit direct entre les deux Grands réside dans le climat international de l'après-guerre. La deuxième guerre mondiale a laissé un bilan humain effroyable (50-60 millions de morts) et un héritage moral conséquent : EU et URSS se sont alors battus ( ensemble ) contre l'anéantissement à l'oeuvre du fait du régime nazi. L'ombre portée de la guerre les oblige à une certaine réserve... et ce d'autant plus qu'ils sont tous deux parmi les premiers fondateurs de l'organisation créée en juin 1945 pour garantir la paix dans le monde : l'Organisation des Nations Unies.
- Doctrines Truman et Jdanov, schémas : http://pierre-mera.ac-versailles.fr/spip.php?article185
- Bref récit de l'affaire Rosenberg : http://histoiregeolyceerombas.over-blog.com/article-13442419.html