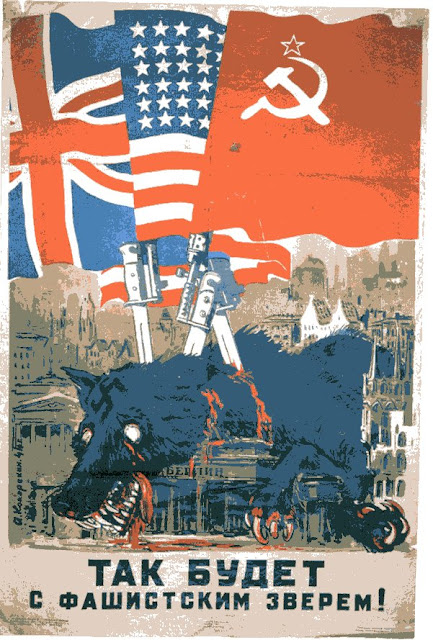|
| Un baobab géant pour éveiller les consciences |
La 17ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte à Durban ( Afrique du Sud) le 28 novembre et devrait durer jusqu'au 9 décembre 2011. Pour sensibiliser la population au problème du réchauffement climatique, montrer que des alternatives sont possibles, la ville de Durban a fait installer un baobab géant - de Noël -, fabriqué à partir de palettes de bois recyclé, éclairé grâce aux passants/pédaleurs d'un instant...
Il s'agit, à DURBAN, de donner une suite au protocole de Kyoto, signé en 1995, entré en vigueur en 2005, ratifié en 2010 par 141 états, et qui arrive à terme en 2012. Les dernières conférences sur le climat ( Copenhague en 2009, Cancun en 2010) ont donné peu de résultats. En ces temps de crise économique, la défense de l'environnement ne semble pas prioritaire... Signe des temps : aucun chef d'Etat et de gouvernement n'a fait le déplacement pour Durban.
Pourtant, les menaces qui pèsent sur l'environnement n'ont pas disparu, et avec elles la nécessité de trouver un accord qui permette de limiter à 2°C le réchauffement climatique terrestre.
Depuis le début des années 2000, les pays pollueurs n'ont pas beaucoup changé. Essentiellement des pays riches, vieux pays industriels : Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni... Mais, comme le montrent la carte et le tableau statistique, la carte des pays pollueurs suit la carte du développement et de l'insertion dans la mondialisation. Aux côtés des pays du Nord, figurent désormais en bonne place des pays émergents ( Chine, Inde, Mexique, Brésil, ...) comme des pays dont le développement est fondé sur l'exploitation intensive des ressources ( Iran, Arabie saoudite).
Selon les données présentées au sommet de Durban, c'est la Chine qui occupe désormais la première place dans le classement 2010 des pays pollueurs, avec 9 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis sur deux ans. Les cinq plus gros pollueurs ( Chine, Etats-Unis, Inde, Russie et Japon ) sont, à eux seuls, à l'origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre.
Pays du Nord gros pollueurs depuis des générations, pays émergents nouveaux pollueurs dont la demande en énergie accompagne le développement : les premiers pressent les seconds de réduire leurs émissions - alors même que certains d'entre eux fournissent des efforts mesurés ( et unilatéraux ) dans ce domaine, comme les Etats-Unis - ; les seconds refusent, au nom de la croissance...
Les signataires du protocole de Kyoto sont nombreux ( presque la totalité des pays du monde). Cela ne signifie par qu'ils aient ratifié le protocole : les Etats-Unis en particulier ne l'ont pas ratifié... Parmi les autres états, des engagements ont été pris par nombre de pays du Nord - les pays du Sud, signataires des accords ne sont pas concernés par cette réduction - pour réduire leur émission de CO2. Ces engagements sont très inégalement remplis, le Japon, le Canada, la Norvège - mais aussi les Etats-Unis qui se sont retirés des négociations dès 2001 - connaissant une différence de plus de 20% entre les émissions 2010 et les engagements.
Voir :
http://www.slateafrique.com/75925/un-baobab-de-noel-illumine-par-des-velos-durban
RFI, 2/12/2011
Le nouvel Observateur, 6/12/2011
Alternatives Internationales, Comment enrayer le réchauffement climatique, décembre 2009, http://www.alternatives-internationales.fr/comment-enrayer-le-rechauffement-climatique_fr_art_882_46097.html