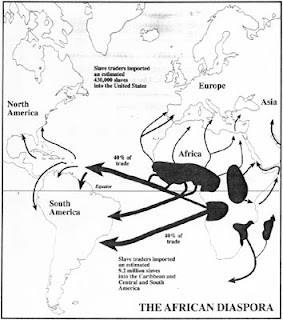La décolonisation de l'Afrique noire commence dans les années 1950. Très rapidement, les difficultés rencontrées par les pays africains nouvellement indépendants, et parmi elles, la difficulté à construire des états démocratiques, sont pointées du doigt. En témoigne cette caricature de 1960, signée Fritz Behrendt, un caricaturiste allemand-hollandais ( né à Berlin en 1925, il s'est réfugié aux Pays-Bas en 1937 et y a vécu pendant la Seconde guerre mondiale. Il participe après-guerre aux plus grands journaux allemands ).
 |
| "Nouvelles gens", caricature de Fritz Behrendt, 1960 |
Dans ce dessin, seuls deux éléments changent entre les deux images : le dictateur noir a remplacé le colon, la servitude des populations reste entière, mais elle est assortie d'une façade de consentement, que symbolisent les slogans "vivat...".
La photo qui suit fait écho à cette vision sombre. Elle représente le dictateur Mobutu, qui a régné sur le Zaïre (ex-Congo belge) de 1965 à 1997, date de son décès. Mobutu Sesse Seko, "président Soleil", le "léopard de Kinshasa", le "roi Léopard", incarne la dictature au service de l'enrichissement personnel : à sa mort, en 1997, sa fortune personnelle ( placée à l'étranger : France, Belgique, Luxembourg, Portugal, Afrique du Sud, Suisse...etc) s'élève à 7 milliards de dollars.
 |
| Mobutu Sesse Seko |
Le parcours de Mobutu, les soutiens qu'il a trouvé auprès des occidentaux sont décrits dans un rapport émanant du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement):
"Mais d’où venait cet argent ? Mobutu possédait de nombreuses parts dans des sociétés, notamment la Gécamines, la société minière d’État seule autorisée à exploiter le cuivre et le cobalt, qui lui reversait une partie des recettes d’exploitation. Il avait orchestré un pillage systématique des fonds publics, en ouvrant par exemple des comptes de la Banque centrale du Zaïre à l’étranger ou en s’octroyant 30 à 40% des investissements publics avec l’accord du Parlement. (...) Selon le Financial Times, le Zaïre a reçu de l’Occident 8,5 milliards $ de subventions et de prêts. « Pourtant, on a du mal à croire qu’il ait été fait grand chose au Zaïre sur le plan économique ou social », indiquait en 1997 un rapport interne de la Banque mondiale. En effet, cet argent a été alloué à Mobutu, non pas pour développer son pays mais parce qu’il était un allié indispensable contre le communisme du temps de la guerre froide. Il avait ainsi ordonné l’assassinat du père de l’indépendance congolaise, Patrice Lumumba, en 1961, allié des soviétiques. Le Zaïre regorgeait par ailleurs de ressources naturelles (cuivre, cobalt, or, diamant, bois) et de terres propices à la culture du café et du cacao. "
( rapport "Biens mal acquis", juin 2009, établi par le CCFD. Rapport qui passe en revue les avoirs détournés de quelque 30 dirigeants de pays en voie de développement - évalués à 100 milliards de dollars au total -, interroge la question de savoir "à qui profite le crime?" et préconise la restitution des biens aux populations pillées).
Pour consulter l'article dans son intégralité :
http://ccfd-terresolidaire.org/BMA/img/PDF/pays/BMA_chap1-2congo.pdf
Sources :
Photo de Mobutu, extraite du manuel d'Histoire Terminale Hachette 2002, p.165
Caricature de Behrendt, manuel d'Histoire Terminale Nathan, 2008, p. 153.
Site du CCFD. Rapport "Biens mal acquis, A qui profite le crime?", juin 2009.