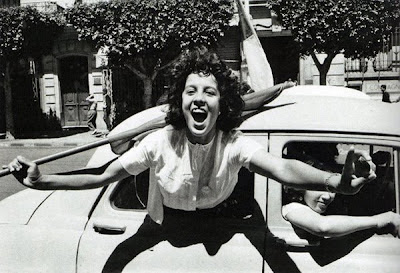Extrait d'un manuel scolaire de l’école primaire
de 1956 sur la résistance.
« La
Deuxième Guerre Mondiale. La Résistance.
En
juin 1940, les Allemands font prisonnière presque toute l'armée française. Ils
envahissent la France tout entière. La plus grande partie de la France reste
ensuite occupée pendant quatre ans par les troupes ennemies. Le reste du pays
est dirigé par un nouveau gouvernement établi à Vichy. Le gouvernement de Vichy
collabore avec les Allemands, c'est-à-dire qu'il accepte de gouverner sous leur
contrôle.
Un
chef français, le général de Gaulle, a réussi à quitter la France et s'est
installé à Londres en Angleterre. Il avertit par radio les Français : « La
guerre, déclare-t-il, n'est pas finie. Continuez à combattre l'ennemi. » Des
milliers de Français courageux organisent alors, en France même, la Résistance.
Ils se réfugient dans le maquis, c'est-à-dire dans les forêts et dans les
montagnes. Leurs petits groupes, mal équipés et mal armés, attaquent avec
héroïsme les troupes et les convois allemands.
Résumé
de la leçon : Les Français sont vaincus par les Allemands en 1940, au début de
la Deuxième Guerre Mondiale. La France est occupée. Mais de Gaulle ordonne aux
Français de continuer la guerre. Les résistants attaquent les convois
allemands. »
Source : A. Bonifacio, P. Maréchal, Histoire de
France, cours élémentaire et moyen, Hachette,
1956.
Questions :
1. Que peut-on dire de la façon dont la
Résistance française et le général de Gaulle sont présentés dans ce document ?
2. Quels acteurs de cette période de l'histoire
de France sont absents ou peu évoqués ?
3. En quoi ce document est-il un outil au
service de la construction de la mémoire de la guerre ?
4. Quelles évolutions majeures
cette vision de l'histoire de la France dans la guerre connaîtra-t-elle dans
les décennies suivantes ?
Les manuels scolaires sont des outils pertinents pour étudier les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France, et particulièrement celles de la Résistance. Pourquoi? Parce qu'ils proposent une vision simplifiée des mémoires officielles, des mémoires dominantes, de celles dont le pouvoir en place entend qu'elles soient transmises aux générations qui n'ont pas connu la guerre.
Ici est proposé à l'étude un extrait d'un manuel destiné aux plus jeunes ( école primaire) en 1956, soit pendant la IV République, un peu plus de 10 ans après la fin du conflit. De Gaulle n'est alors pas au pouvoir, mais la mémoire gaulliste de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance inspire très largement la représentation du conflit livrée aux enfants.
( Question 1 ) Le texte se compose de deux paragraphes : le premier fait état de la défaite, de l'occupation du territoire et de l'existence d'un gouvernement qui fait le choix de la collaboration (le gouvernement de Vichy) ; le second, présenté comme une antithèse du premier, met en évidence le rôle de la Résistance et de De Gaulle. Le général de Gaulle est posé comme l'initiateur de la Résistance. Il est celui qui fait le choix de l'exil ( "il quitte la France") - et ce lorsque la solution de l'armistice est adoptée par le gouvernement, choix qui est présenté ici comme un choix courageux. Il est aussi celui qui "avertit (...) les Français" : le texte fait évidemment allusion à l'appel du 18 juin 1940, puis aux autres appels lancés depuis Londres et la BBC par le Général aux Français pour inviter à la Résistance contre l'ennemi. Conséquence de cet appel selon le manuel scolaire, "des milliers de Français courageux organisent alors, en France même, la Résistance". La résistance intérieure est donc posée comme la résultante de l'impulsion donnée, depuis Londres, par le général de Gaulle. La vision qui est donnée de la Résistance est celle d'une résistance masculine, militaire ("ils attaquent", "le maquis"), héroïque ("des milliers" - mais la France compte 40 millions d'habitants - qui forment des "petits groupes mal équipés et mal armés"). C'est l'armée de l'ombre qui est montrée, celle que mettras en scène le film éponyme de Jean Pierre Melville (1969), celle dont le film de René Clair, La bataille du rail, avait glorifié en 1946.
(Question 2). De toute évidence, une telle démonstration, de plus effectuée dans un espace très limité, ne peut que passer sous silence certains acteurs. Il faut d'abord insister sur le fait que Vichy est néanmoins évoqué ( contrairement à la vision caricaturale - à laquelle certains aboutissent parfois - selon laquelle l'évocation de la Résistance impliquerait un silence total sur Vichy) . Pétain n'est pas nommé, mais la collaboration de Vichy est mentionnée, même si elle est présentée - ce que les historiens contrediront plus tard - comme une collaboration subie et non comme une collaboration choisie.
| Pétain, procès devant la Haute Cour de Justice, 1945 |
Trois acteurs majeurs sont complètement absents, ou peu s'en faut, du résumé proposé.
D'abord, les armées alliées (Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni), dont le rôle essentiel à la Libération du territoire n'est pas même évoqué. Ce silence rehausse évidemment le rôle prêté à la Résistance, qui apparaît comme le seul acteur de la Libération.
| Débarquement de Normandie, 6 juin 1944 |
Deuxième absent, du moins nommément : les différents mouvements formant la Résistance intérieure, et particulièrement les communistes. Alors que les communistes sont alors à l'origine d'une mémoire spécifique de la Résistance, insistant sur le rôle majeur qu'ils ont joué ( le Parti des fusillés), les résistants sont présentés dans le manuel sous la seule étiquette de "Français". C'est important parce que cela souligne la volonté de rassemblement qui a présidé à la construction de la mémoire gaulliste.
| Parti communiste, affiche d'octobre 1945, à l'occasion des législatives |
Enfin le texte évoque seulement le combat mené contre l'occupation, mais pas les victimes de ce combat - les fusillés, les déportés de répression - non plus que celles de la politique de persécution menée sur le territoire : Juifs, tsiganes. La vision proposée est vraiment militaire : seuls les combattants, réguliers ou non, en capacité de se battre ou non ( les prisonniers de guerre ), sont mentionnés.
(Question 3) Ce document est donc un outil au service de la construction de la mémoire de la guerre, puisqu'il propose une représentation de la guerre à destination d'un public d'enfants qui ne l'ont pas connue - mais dont les parents, eux, l'ont vécue. Le manuel scolaire joue un rôle majeur dans la transmission des visions dominantes que l'on choisit de donner de l'événement. Il est à la fois le témoin des connaissances de l'époque ( peu de recherches historiennes alors sur Vichy, les archives étant fermées ; une histoire de la guerre et de la Résistance qui est, pour beaucoup, le fait des acteurs et témoins ), et le témoin des visions dominantes, de celles que le pouvoir en place entend transmettre.
(Question 4) Cette vision de la France dans la guerre va connaître des évolutions majeures.
D'abord, à partir des années 1970, le rôle de Vichy va être précisé sous l'impulsion d'abord d'historiens étrangers comme Robert Paxton ( La France de Vichy, 1973), relayé par des historiens français dans les années 1970 et 1980 surtout. La vision de Vichy s'enrichit et se précise. C'est un Etat collaborateur - ce que l'on savait et disait déjà depuis le procès de Pétain par la Haute Cour de Justice en 1945 - , qui a fait le choix de la collaboration. C'est par ailleurs un Etat fort, qui s'apparente à une monarchie personnelle et a totalement rompu avec la tradition républicaine et démocratique. C'est enfin un régime antisémite qui a participé à la mise en oeuvre de la Solution Finale.
Ensuite, il faut noter que les années 1970 sont celles du réveil de la mémoire de la Shoah, qui prend bien sûr la forme d'un recueil des témoignages et de l'apparition de cette mémoire au cinéma, mais qui prend aussi la forme du travail des historiens. Les premiers travaux émanent de chercheurs isolés ( comme le couple Klarsfeld à l'origine de la première liste des déportés juifs partis de France). Ils sont relayés ensuite par des travaux émanant des structures institutionnelles de recherche ( citons par exemple les travaux récents sur la spoliation des biens juifs pendant la guerre).
Robert Paxton, La France de Vichy, Seuil, 1973
Serge Klarsfeld, Le mémorial de la déportation des Juifs de France, 1978
La persécution des Juifs de France (1940-1944) et le rétablissement de la légalité républicaine. Recueil des textes officiels , ouvrage réalisé sous la direction de Claire Andrieu, avec la participation de Serge Klarsfeld et Annette Wieviorka, et la collaboration de Olivier Cariguel et Cécilia Kapitz. Avec cédérom. Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, Paris, La Documentation Française, 2000, 530 p.