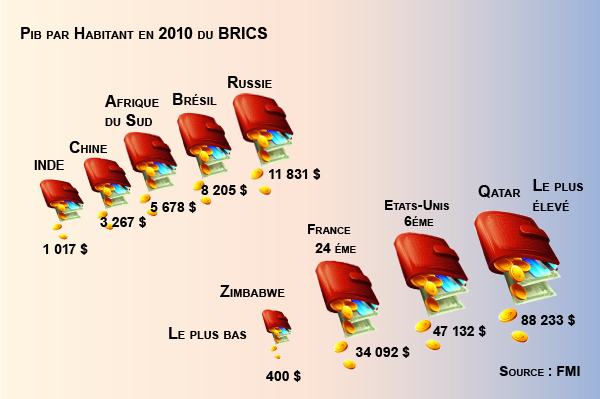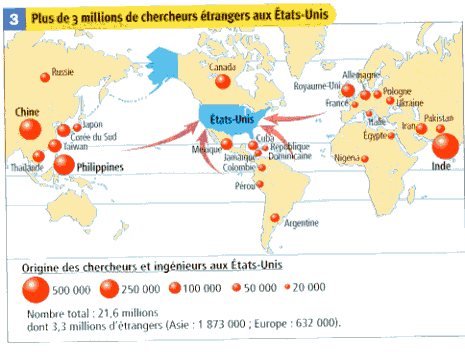| Plantu, les touristes du Nord dans les pays du Sud |
Les journaux The Observer et le Guardian relancent le débat, autour du tourisme et de l'attitude des touristes, en publiant une vidéo mettant en scène ce qui peut être appelé un "safari humain" :
Cette vidéo, tournée aux îles Andaman ( dans le golfe du Bengale ) montre des femmes de la tribu Jarawa forcées de danser pour des touristes indiens. Un policier, rémunéré par les touristes, leur intime l'ordre de danser contre de la nourriture.
http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/jan/07/andaman-islanders-human-safari-video
http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/jan/07/andaman-islanders-human-safari-video
| Membres de la tribu des Mashro-Piro, |
La pratique du safari humain menace d'autres tribus et d'autres lieux. Courrier International a ainsi fait paraître un article évoquant le sort de la tribu des Mashco-Piro, l'une des 15 tribus indiennes du Pérou n'ayant pas de contact régulier avec le monde extérieur (cette tribu vit dans le parc national du Manu) , actuellement menacée par l'organisation de "safaris humains" destinés à permettre aux touristes de photographier ces tribus indiennes isolées de l'Amazonie péruvienne. Pour les touristes, il s'agit ni plus ni moins d'approcher des individus isolés et " les prendre en photo comme des jaguars pendant un safari". Pour les tribus en question, cette approche représente une véritable menace puisque ces tribus sont particulièrement vulnérables : "la transmission d'un simple rhume pourrait leur être fatale", expliquent certains voyagistes.
Le "safari humain" pose évidemment la question du rapport à l'Autre. Ici, le touriste-roi exige la rencontre avec des individus qui ne la souhaitent pas. La confrontation est inégale, fruit d'un rapport de force lié à la possibilité de payer, ou non, des voyagistes inégalement respectueux des droits des tribus.
 |
| Indiens Galibis, affiche de Jules Chéret, 1882 ( source bnf) |
Ce rapport de soumission n'est pas sans rappeler les zoos humains, tels qu'ils ont existé sur le sol français à la grande époque coloniale. De 1875 aux années 1930, la République française a en effet régulièrement organisé l'exhibition de populations "exotiques" : indiens galibis, zoulous, canaques...
 |
| Portrait des Kali'na, Indiens de Guyane, exhibés au Jardin d'acclimatation, Paris, 1892, |
Sources :
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/02/le-scandale-des-safaris-humains-gagne-l-amazonie
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/02/le-scandale-des-safaris-humains-gagne-l-amazonie