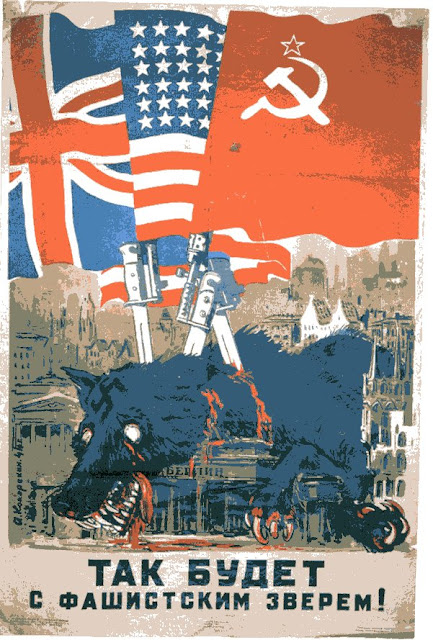Epreuve de bac : L'URSS au grand air, étude de document mineure ( Terminale, séries générales)
 |
| L'URSS au grand air, affiche du mouvement Paix et Liberté, 1951 |
Questions :
1. Présentez le document
2. Expliquez précisément la scène encadrée relative aux démocraties populaires ( la scène encadrée, qui n'apparaît pas ici, est celle qui met en vis-à-vis Staline et les "pays libérés", en haut à gauche de l'affiche)
3. En analysant deux des scènes présentées sur ce document ( en dehors de celle évoquée en Q2), montrez quel est le point de vue des auteurs.
4. Identifiez différents aspects du système soviétique illustrés dans ce document
5. Que savez vous de l'évolution du système soviétique dans le courant des années 1950?
Cette étude de document suppose des connaissances sur le modèle communiste soviétique et sur la Guerre froide.
1. Rappel : présenter un document suppose de s'intéresser à : auteur, nature, contexte, enjeu, destinataire.
Ici, le plus simple est de commencer par souligner la nature du document, une affiche de propagande, vecteur particulièrement utilisé pendant la GF à propos de laquelle on a parlé de guerre des affiches. Une affiche de propagande donc, dont l'auteur est le mouvement Paix et Liberté, une association française anticommuniste née dans les années 1950. Cette association, créée par le député radical Jean-Paul David, a pour but de répondre, sur le sol français marqué par une forte emprise du PCF, à la propagande orchestrée par ce parti.
Le destinataire de l'affiche est donc le public français, dans une France où le PCF est encore un parti très puissant, passé depuis 1947 dans l'opposition et animateur d'une campagne pacifiste, pro-soviétique, dans le cadre de l'Appel de Stockholm.
Cette affiche prend la forme d'une brochure touristique qui mettrait en avant les caractéristiques du territoire soviétique ( fond de carte dans lequel apparaissent des scénettes dont l'emplacement correspond à la situation géographique). Sous couvert de présentation, l'affiche se livre à une charge contre le modèle soviétique des années 1950, et particulièrement contre son chef, Staline, au pouvoir en tant que secrétaire général du PCUS depuis 1928. Nous sommes alors en pleine guerre froide : la crise de Berlin vient de s'achever, la guerre de Corée ( qui oppose de manière indirecte URSS et Etats-Unis ) bat son plein.
Ce qui fait défaut aux présentations est souvent la mise en évidence du contexte : Guerre froide, sur le territoire européen, ici français, une guerre qui se traduit par des crises ( Berlin, Corée) et par un conflit idéologique dans lequel l'affiche joue un rôle majeur pour dénoncer le modèle opposé.
2. La scène encadrée est à la charnière entre le territoire soviétique et celui des démocraties populaires à l'ouest. Elle met en scène d'une part, un cochon auquel sont apportées des vivres, et qui fait donc "bonne chère" et d'autre part - de l'autre côté de la frontière - des individus attablés sommés de livrer leurs vivres sous la menace d'armes. Sous ces individus apparaît la mention " pays libérés". Ces " pays libérés" l'ont été par l'Armée Rouge en 1944/1945 lors de la libération des territoires de l'Europe de l'Est par l'URSS. Comme le signale l'insistance sur le mot "libérés", cette libération se traduit de fait par une occupation par l'Armée Rouge et par une soumission. Ce que dénonce donc d'abord l'affiche, c'est la réalité d'une libération - libération de l'occupation hitlérienne - qui se meut en une autre occupation - celle par l'Armée rouge. De plus, ces territoires occupés auraient dû, en application des accords de Yalta, évoluer vers la liberté politique. Mais, deuxième problème soulevé par l'ironie du terme " libération", les élections libres n'ont pas eu lieu ( Pologne) ou l'Armée rouge a immédiatement imposé un régime communiste ( Roumanie). Entre 1945 et 1948, ces territoires "libérés" par l'Armée rouge ont été satellisés par l'URSS : gouvernement communiste ( en 1948, par le "coup de Prague" est parachevée la transformation des régimes en régimes communistes), stalinisation ( les partis communistes des pays de l'Est sont l'objet d'une épuration drastique dans le cadre de grands procès dans les années 1948 et suivantes). Enfin, ces pays transformés en démocraties populaires ( Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et, depuis 1949, RDA), sont liés à l'URSS par le CAEM : cette organisation économique permet, d'après les auteurs de l'affiche, le pillage des ressources des pays de l'Est au profit de l'URSS.
Lacune majeure des réponses : démocraties populaires non citées. ( il faut impérativement les nommer). Et surtout, pas d'explication claire sur leur adoption obligée du système politique soviétique ( ce sont, comme l'URSS, des démocraties populaires, avec un parti communiste unique ET dominant) , leur alignement idéologique ( grâce au Kominform), leur sujétion économique ( dans le cadre du CAEM).
3. Impossible de relever ici toutes les scènes.
Il faut relever la dénonciation de la figure de Staline, qui apparaît à 10 occasions et est reconnaissable à sa moustache et à la casquette de maréchal flanquée de l'étoile rouge. Cette critique de l'"homme d'acier" est celle du culte de la personnalité ( scénette "au musée"), de la dictature d'un régime totalitaire qui impose SA parole ( scénette de Staline vociférant depuis le Kremlin : "éducation"), de l'instrumentalisation de l'art au service du régime ( scénette "musées"), de la dictature aveugle ( "équitation"). Le régime soviétique des années 1950 est, selon les auteurs de cette affiche, un régime dictatorial, usant de la répression ("cures de repos", "excursions organisées", "stations thermales"... dénoncent l'archipel du goulag, où les opposants sont "rééduqués" par le travail au profit du régime - une main d'oeuvre abondante, servile, renouvelable - ), dans lequel le Parti est au coeur d'un système meurtrier ( la rose des vents place la faucille et le marteau, symboles du PCUS, au coeur d'un système de mort / cadavres embrochés), et dans lequel la police est à l'oeuvre (partout des policiers encadrent la répression et on les voit particulièrement à l'oeuvre dans la scénette "surveillance").
L'essentiel pour cette question est d'être très précis dans la description de l'image. Ne pas chercher à en décrire plus de deux, mais les décrire de manière extrêmement précise. Et tirer de cette description des notions plus générales ( culte de la personnalité, régime policier...), pour pouvoir répondre à la question posée / point de vue des auteurs : évidemment hostile et critique. Le but des auteurs est de "dévoiler" ce qui se cache sous la propagande soviétique.
4. Les aspects du régime soviétique attendus - qui seront diversement développés selon le choix de scénettes commentées à la question précédente - sont : culte de la personnalité, poids du Parti, régime policier, arbitraire, dictature, régime totalitaire, négation des libertés.
Un autre aspect (non évoqué ici en question 3) est celui mis en évidence par la scène "footing" : l'armée - puissante - peut éventuellement sortir des frontières. Allusion au fait que l'URSS impose aux démocraties populaires considérées comme des "pays frères" de s'aligner totalement sur l'URSS. Sauf à courir le risque de la répression. C'est une façon d'évoquer l'expansionnisme soviétique, menace qui est particulièrement utilisée dans les pays occidentaux.
Cette question invite à évoquer des aspects, des caractéristiques : il faut donc mobiliser les notions - clés vues dans le cours sur le modèle soviétique.
5. Comme le document date du début des années 1950 - et donc de la période stalinienne - , la question invite à évoquer l'après-Staline. Donc il faut d'abord rappeler son décès en mars 1953, puis l'évolution qui a suivi. Sous l'égide de Khrouchtchev, une première libéralisation du régime va avoir lieu, qui se traduit en particulier par la libération de nombreux prisonniers du Goulag. Surtout, en février 1956, lors du 20ème congrès du PCUS, Khrouchtchev se livre à une dénonciation du régime stalinien. Mais l'ouverture affichée par le 20 ème Congrès ne signifie pas que les démocraties populaires puissent se démarquer de l'URSS. Il faut évoquer ici la répression des manifestations berlinoises ( juin 1953), et surtout le coup d'arrêt mis à la révolution hongroise (novembre 1956).
La dernière question est une question de cours. Le document n'est plus sollicité, il faut mobiliser des connaissances. Concision, précision sont ici attendues.
Un autre corrigé sur le même document (questions légèrement différentes) :
D'autres affiches du mouvement Paix et Liberté :