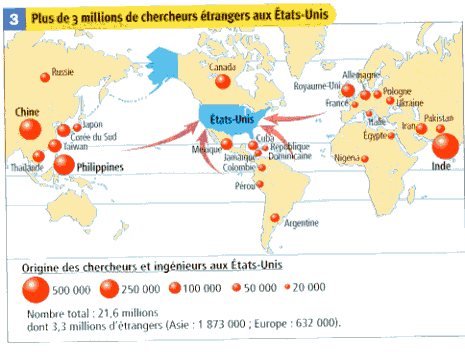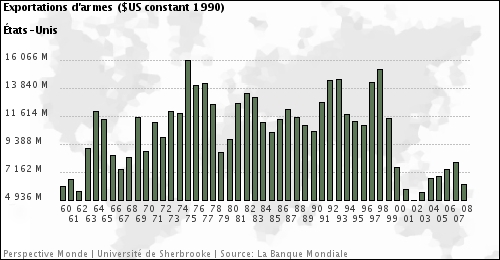|
| Source : manuel Magnard |
Ce premier schéma met en évidence deux idées majeures : la mer des caraïbes est une interface américaine, qui met en contact deux mondes au développement très différent, de part et d'autre de la limite Nord/Sud. C'est ce que traduit l'IDH, élevé au Nord - aux Etats-Unis (dans les états de Floride, Nouvelle Orléans, Texas ), moindre au Sud - même si le Sud est marqué par une disparité de situations, les puissances émergentes ( Mexique, Venezuela) mais aussi les petites Antilles ( parmi lesquelles figurent les régions ultra-périphériques que sont la Martinique et la Guadeloupe), et enfin Cuba, se signalant par un IDH élevé, voire très élevé.
La deuxième idée illustrée par ce schéma est celle de ressources inégalement réparties : les ressources en pétrole expliquent, pour partie, la situation du Mexique et du Venezuela. Parmi les ressources majeures des îles des Caraïbes, figure aussi en bonne place le tourisme, de même que l'attraction que représentent les paradis fiscaux. Ces deux dernières ressources montrent que le bassin caraïbe est aussi une interface mondiale.
 |
| Source : manuel Magnard |
Ce deuxième schéma permet d'illustrer une partie consacrée aux flux ( l'espace caraïbe : un espace traversé par des flux). L'idée défendue ici est évidemment celle d'un rapport inégal, puisque deux types de flux se croisent : des flux Nord/Sud qui sont des flux d'IDE et d'aides - émanant soit des Etats-Unis, soit de l'Union européenne pour les petites Antilles - ; des flux Sud/Nord, qui sont des flux de migrants - traduction du déséquilibre de richesses - , ou des flux de drogue, - traduction de la demande émanant des pays riches du Nord.
Cette vision est évidemment un peu caricaturale, puisqu'elle ne montre pas les flux Sud/Nord de produits manufacturés ( liés aux multiples délocalisations ). Elle a pour but de mettre en évidence le lien entre déséquilibre économique et flux, donc d'illustrer l'inégale insertion des espaces dans la mondialisation.
 |
| Source : manuel Magnard |
Un schéma qui illustre l'idée de "Méditerranée américaine", soit d'espace dominé par les Etats-Unis.
L'influence américaine se traduit d'abord par les organisations économiques qui sont liées aux Etats-Unis : initiée par eux ( l'ALENA), ou associés ( Marché Commun centre-américain ou CAFTA : Central America Free Trade Agreement).
Le schéma montre par ailleurs que l'influence américaine s'étend sur tout le bassin des caraïbes. Il faudrait illustrer ce propos en mentionnant les diverses formes de l'influence américaine : territoire sous tutelle ( Porto Rico), bases militaires ( Guantanamo à Cuba, mais aussi au Honduras), interventions militaires ... L'embargo auquel est soumis Cuba depuis 1962 est mentionné de manière spécifique.
Bien que rétrocédé au Panama, le canal de Panama est toujours un élément de la puissance des Etats-Unis, qui le considèrent comme une voie d'eau intérieure, les bateaux battant pavillon américain ayant priorité sur les autres.
Par rapport à celle des Etats-Unis, l'influence que l'Union européenne exerce par l'intermédiaire des Petites Antilles fait piètre figure.
Source des schémas :
manuel Magnard, 2012.